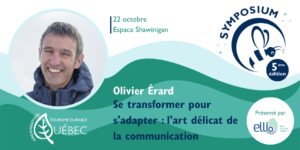Québec, 29 octobre 2025 – Tourisme durable Québec (TDQ) — Bilan du Symposium: Communiquer pour transformer le tourisme durable au Québec
Le Symposium sur la communication en tourisme durable, tenu en Mauricie, a rassemblé des élus, experts, entrepreneurs, destinations et chercheurs autour d’un même constat : la communication est un levier essentiel de la transition durable. Dès les mots d’ouverture, le maire a rappelé l’importance de travailler avec la communauté pour faire du tourisme un moteur de vitalité locale, ancré dans son territoire et ses valeurs.
Le lieu même du symposium – l’ancienne aluminerie d’Alcove, destinée à devenir le futur musée de l’Aluminium – symbolisait la transformation : de l’industrie lourde vers un espace de culture, d’innovation et de mémoire collective.
Cette métaphore a donné le ton à l’événement : se transformer pour s’adapter, en réinventant la manière de raconter et de faire vivre le tourisme durable.
Le fil conducteur: communiquer pour relier et inspirer
Les échanges ont souligné que la communication ne se limite pas à informer ou à promouvoir : elle structure les relations, façonne les récits et oriente les comportements. Plusieurs intervenants ont insisté sur le fait que même les choses les plus difficiles peuvent se réaliser avec la communication.
Pour l’Association Touristique Régionale de la Mauricie, la communication est un vecteur de mise en valeur de la richesse territoriale et de cohésion régionale. La destination veut faire rayonner son offre en alliant durabilité, authenticité et proximité, en valorisant le tourisme lent, respectueux des communautés et de l’environnement.
Les discussions ont convergé vers l’idée que la communication relie les acteurs du changement. Chaque organisation, chaque individu est porteur d’un fragment de la transition : ensemble, ils forment une intelligence collective. Les mots, les symboles et les récits partagés deviennent des catalyseurs d’actions, unifiant les efforts des acteurs autour d’une vision commune.

Conférences inspirantes: de la théorie à la transformation
Olivier Érard, dans sa conférence intitulée L’art délicat de la communication, a invité le public à réfléchir sur le sens véritable des mots et sur la portée des messages que nous véhiculons lorsqu’il est question de durabilité. Selon lui, la « transition durable » ne peut se réduire à un simple slogan : elle doit s’incarner dans un processus profond de transformation systémique. Il a rappelé qu’un système est composé d’éléments interreliés, visibles ou non, et que la communication est un des leviers essentiels car il est en mesure d’activer la résilience des individus et des organisations face aux chocs.
À travers l’exemple de sa propre expérience de gestion d’une station de ski frappée par la raréfaction de la neige, il a illustré comment l’intuition, la concertation et la clarté du message peuvent transformer une crise en véritable occasion d’innovation. En s’appuyant sur une démarche de consentement collectif, fondée sur l’écoute du terrain et la co-construction des solutions, il a montré que la communication ne consiste pas seulement à transmettre de l’information, mais à créer les conditions de l’action partagée.
Cette réflexion sur la transformation, à la fois individuelle et collective, a trouvé un écho naturel dans la présentation de Valérie Vedrines, directrice de Masse Critique, qui a choisi de placer l’éthique au cœur de la communication touristique. Là où Olivier Érard insistait sur le pouvoir de la communication pour susciter la résilience et l’engagement, Valérie Vedrines a rappelé que cette communication doit également être responsable, transparente et authentique.
Selon elle, le tourisme durable ne se joue pas seulement dans les pratiques sur le terrain, mais aussi dans la manière dont on en raconte l’histoire. Les récits façonnent les imaginaires, orientent les comportements et influencent la perception du public. Pour que la communication soit un moteur de changement et non un outil de façade, elle doit s’appuyer sur des valeurs d’intégrité, de cohérence et d’inclusion.
Elle a mis en garde contre les dérives de l’écoblanchiment ou du socio-blanchiment, et souligné l’importance de représenter la diversité réelle du Québec touristique, en évitant les biais sexistes, racistes ou culturels trop souvent véhiculés par les images et les campagnes. Enfin, elle a invité les professionnels à penser la communication dans toute sa durée de vie : de la conception à la diffusion, jusqu’à la fin des supports et des messages, afin d’intégrer pleinement la durabilité jusque dans la matérialité de la parole publique.
Ainsi, les interventions d’Olivier Érard et de Valérie Vedrines se sont répondues comme deux volets complémentaires d’une même réflexion : communiquer pour transformer, mais le faire avec intelligence, sens et éthique.

Les bonnes pratiques de communication durable
Animé par Valérie Vedrines, le premier panel a fait basculer la réflexion du «pourquoi communiquer» vers le «comment bien communiquer». En réunissant Cécile Lugand (Kéroul), Fanny Beaulieu-Cormier (Tourisme Montréal) et Karine Casault (Planetair), la discussion a articulé trois exigences indissociables: accessibilité, inclusivité et justesse environnementale.
Kéroul a rappelé une réalité structurante — 27 % de la population vit une situation de handicap — qui oblige à concevoir des messages et des dispositifs universellement accessibles et véritablement représentatifs de la diversité des publics. Tourisme Montréal a montré comment passer des intentions aux pratiques, avec un audit de communication inclusive, la formation des équipes et des guides terminologiques pour bannir les expressions inappropriées. Du côté de l’environnement, Planetair a ancré le débat dans la transparence : tous les crédits carbone ne se valent pas, et il faut documenter les démarches, leurs hypothèses et leurs effets, pour éviter les promesses creuses. En filigrane, un même frein est apparu : la peur de mal communiquer et le manque de ressources internes. Les panélistes ont proposé une voie simple et exigeante: former, outiller et valoriser les progrès, même imparfaits, plutôt que de se taire.

Communiquer avec justesse – La perspective autochtone
Le panel autochtone, animé par Virginie Zingraff (Tourisme Mauricie) et Pierre Kanapé (Tourisme Autochtone Québec), a abordé la question de la communication juste et respectueuse.
Stéphanie Nika Trottier (Tourisme Odanak) et Isabelle Milord (Tourisme Baie-James) ont rappelé que la communication juste passe par l’écoute, l’humilité et la connaissance des protocoles culturels. Le message clé implique d’apprendre à se connaître avant de communiquer.
Une communication éthique implique :
- D’inclure les communautés dès le départ dans les projets;
- D’utiliser les bons termes, validés avec les représentants concernés;
- D’éviter les symboles détournés ou l’appropriation culturelle;
- De bâtir des relations sincères et continues, au-delà de la simple collaboration ponctuelle.
Dans cet esprit, la communication durable se révèle être une démarche d’équilibre : entre visibilité et justesse, innovation et sobriété, parole et action. Ensemble, ces panels ont tracé les contours d’une nouvelle écologie de la communication, où chaque mot, chaque image et chaque canal participent à la transformation concrète du tourisme.
Des solutions innovantes en rafale
Une fois de plus, les startups du Mt Lab ont présenté leurs solutions innovantes en formule éclair de 90 secondes chacune. De belles découvertes étaient au rendez-vous! Outre ces présentations, une quinzaine d’exposants étaient présents pour proposer des pistes sw solutions aux enjeux de la transition durabl

Un après-midi riche en apprentissages
La suite a déplacé le projecteur de la fabrique des messages vers leur amplification. Avec Maryse Boivin, Marie-Julie Gagnon, Geneviève Blouin et Véronique Buisson, on a vu comment médias, ambassadeurs et outils numériques peuvent démultiplier l’impact des actions durables. L’outil GreenCAST illustre ce passage à l’échelle : par l’analyse sémantique des avis en ligne, il révèle ce que les clientèles perçoivent réellement des engagements (points forts, angles morts, signaux faibles), donnant aux organisations une boussole pour ajuster leurs pratiques et leurs récits. À l’international, le macaron vert du Guide Michelin agit comme label d’excellence pour le tourisme gourmand responsable : il crédibilise les efforts, attire un public curieux et impose un standard de qualité qui rejaillit sur l’ensemble d’une destination. Au niveau local, les communautés d’ambassadeurs agissent comme porte-parole, une excellente initiative pour la promotion d’une région. D’un point de vue journalistique, l’oeil aiguisé de Marie-Julie Gagnon lui permet de refuser certaines invitations qui ne répondent pas à ses valeurs, et de focaliser ses recherches sur des endroits touristiques moins connus. Autrement dit, mieux communiquer ne suffit pas ; il faut aussi être entendu par les bons relais et dans les bons espaces.

Cette dynamique d’amplification suppose une cohérence opérationnelle. L’intervention d’Hélène Gervais (RECYC-QUÉBEC) l’a concrétisée dans le champ de l’économie circulaire en hébergement. Elle a montré que l’adhésion des employés et des clients se gagne par une ingénierie fine de la communication : affichage aux bons endroits, capsules vidéo, formations ciblées, partage des résultats et coordination inter-départements. La clé n’est pas le volume de messages, mais leur pertinence et leur rythme, alignés sur des gestes concrets (bannir les produits à usage unique, reconditionner le mobilier, valoriser les matières, etc.). Ici, la communication cesse d’être décorative : elle devient infrastructure d’exécution.

Ensuite, Yasmine Benbelaid (UQAC), Myriam Nadeau (RCEM) et Simon Girard (Navette Nature) ont présenté le projet Nature sans voiture qui repose sur l’accès à la nature en transport en commun. Cette logique d’infrastructure a trouvé un prolongement concret dans le panel Du message à l’impact, où la communication a été présentée non plus seulement comme un outil, mais comme une structure de gouvernance collective. Dans un contexte où la transition touristique exige des décisions rapides, aligner les acteurs autour d’un cap commun devient essentiel.
Les échanges ont montré comment la communication peut relier opérateurs, ATR, municipalités, transporteurs, organisations communautaires et visiteurs pour créer une vision cohérente de la mobilité durable. L’initiative Nature sans voiture illustre bien cette approche : des partenaires issus de milieux variés ont coordonné leurs messages, leurs données et leurs services pour faciliter l’accès aux destinations nature, réduire les frictions et favoriser l’inclusion.
En forgeant un langage commun et des canaux partagés, ce type de démarche permet de répartir plus équitablement les flux touristiques, de décarboner l’expérience de voyage et de renforcer la cohérence du message durable à chaque point de contact. Ainsi, la communication se fait charpente de la transition, soutenant à la fois la stratégie, la mobilisation et la transformation des pratiques.

Pour prolonger cette réflexion, Solène April (Pôle d’innovation en tourisme durable – MT Lab) a présenté un parcours d’innovation en huit étapes, destiné à accompagner les organisations dans la structuration et le déploiement de leurs projets de communication durable. On y retrouve une posture — ouverture, expérimentation, collaboration et acceptation de l’imperfection — et une méthode permettant de passer de l’intuition à l’action, du pitch au plan d’exécution, en s’adaptant aux contraintes réelles du secteur (saisonnalité, roulement, petites équipes). Ce cadre rend possible l’itération continue et la co-création, en phase avec l’esprit du tourisme durable : apprendre, ajuster, recommencer.

Enfin, la question du numérique a bouclé la boucle. Avec Amélie-Christine Richard (Tourisme Mauricie) et Pierre-Yves Misme (Décarbonade), la communauté a été invitée à considérer l’empreinte d’un levier souvent invisible : le digital, qui représente près de 40 % des budgets marketing. La sobriété numérique, ont-ils rappelé, consiste à « faire mieux avec moins » : privilégier les médias locaux, réduire le superflu, mesurer la performance autrement et privilégier la qualité à la quantité.
Dans cet esprit, la communication durable se révèle être une démarche d’équilibre : entre visibilité et justesse, innovation et sobriété, parole et action. Ensemble, ces panels ont tracé les contours d’une nouvelle écologie de la communication, où chaque mot, chaque image et chaque canal participent à la transformation concrète du tourisme.

Les nouvelles perspectives de TDQ
Tourisme durable Québec (TDQ) a présenté ses orientations stratégiques :
- Outiller, former et relier les acteurs du tourisme durable
- Affirmer son rôle de référence en tourisme durable
- Créer les conditions et les leviers nécessaires à l’accélération de la transition durable
- Valoriser et rendre visible les efforts de l’industrie
Elle a aussi insisté sur quelques actions déjà mises en place pour atteindre ses objectifs:
- Financer des solutions concrètes par le Fonds FDET;
- Former les organisations touristiques (GSTC, CQRHT, Bilan GES Tourisme).
TDQ affirme sa nouvelle mission : accélérer la transition responsable et durable du tourisme au Québec en guidant les professionnels de l’industrie et en mobilisant ressources et expertises autour de projets structurants.
Une communication vraie, inclusive et transformative
En clôture, la ministre du Tourisme, Amélie Dionne, a rappelé les trois piliers de la stratégie ministérielle : mobiliser, informer et renforcer la résilience des entreprises.
La communication est un fil conducteur de cette transition — un outil de cohésion, de compréhension mutuelle et d’action collective. Le Symposium s’est ainsi imposé comme un laboratoire vivant où s’est dessinée une vision partagée : celle d’un tourisme québécois durable, inclusif et inspirant, porté par la puissance d’un récit collectif.
Rediffusion
L’ensemble des contenus est disponible en rediffusion. Vous pouvez vous procurer le coffret de rediffusion via ce lien.
Merci à nos partenaires
Cet événement n’aurait pu avoir lieu sans le soutien de nombreux partenaires engagés qui font une réelle différence dans l’avenir durable du milieu touristique. Tourisme durable Québec souhaite remercier sincèrement son partenaire régional, Tourisme Mauricie.

Elle souhaite aussi souligner la contribution de ses partenaires solidaires, le ministère du Tourisme du Québec et Hydro-Québec, ainsi que tous ses autres partenaires qui appuient la tenue de l’événement. Vous pouvez les retrouver sur la page de l’événement, et y découvrir tous les détails.
Pour rejoindre le mouvement Tourisme durable Québec, consultez la section Devenir membre de notre site web.
Par Yasmine Benbelaid, en collaboration avec Laurence Boucher
Crédit photos: Hélie Vincent